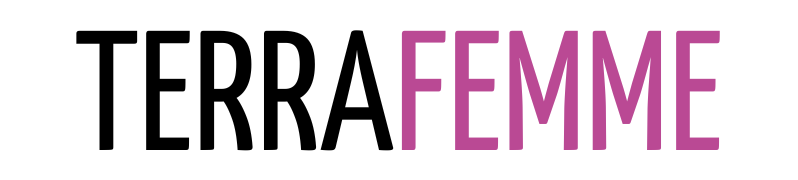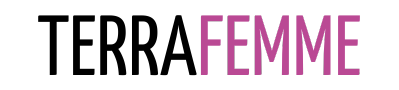Dans « Ann d’Angleterre », Julia Deck se plonge au chevet de sa mère tombée victime d’un grave AVC. Ce moment dramatique déclenche chez elle le besoin impérieux de comprendre celle qui lui est la plus proche, mais dont elle a toujours senti l’ombre d’un mystère. Entre autofiction et enquête biographique, l’autrice trace un double récit : d’un côté la lutte pour la survie de la mère, de l’autre la reconstruction de son passé inconnu.
L’autofiction comme espace de vérité
Avec « Ann d’Angleterre » (Adelphi), primé Médicis en 2024, Julia Deck signe son premier roman d’inspiration autobiographique. Fidèle à son style incisif, elle adopte la forme de l’autofiction pour mêler intime et documentaire. Le point de départ est frappant : le narrateur retrouve sa mère gisant au sol, inconsciente. L’angoisse de la perte sert de déclencheur à l’écriture et rend ce récit à la fois poignant et rigoureux. Loin du simple témoignage, Deck interroge les frontières entre la mémoire, le silence familial et la nécessité de la fiction pour approcher ce qui nous échappe.
Le choc de l’AVC et l’épreuve médicale
Après l’accident vasculaire, commence pour l’auteure un véritable parcours du combattant au sein de l’hôpital et des institutions médicales. Elle décrit :
- Des services débordés et une bureaucratie lourde, où le patient devient un dossier.
- La quête effrénée d’une place en rééducation, face à la négociation des budgets et aux délais interminables.
- Une réflexion amère sur le « marché des maisons de retraite » qui se dessine au détour des couloirs, mélange de compassion et de calcul commercial.
Julia Deck confie son désarroi : « Je m’attendais à des réponses médicales, j’ai reçu des réponses administratives. » Ce constat social rend son texte aussi politique que littéraire, dénonçant l’état des soins publics après la pandémie.
Aux origines de « Ann » : une enfance ouvrière en Angleterre
En parallèle de ce récit contemporain, l’écrivaine remonte le fil du temps pour raconter la jeunesse de sa mère, Ann. Née dans le Yorkshire des années 1930, issue d’une famille modeste :
- Elle grandit au milieu des usines et des grèves, dans une Angleterre encore marquée par la crise économique.
- Son amour précoce pour la littérature lui offre une échappatoire et lui vaut des bourses d’études brillantes.
- Elle profite des années 1960-1970, période d’émancipation, pour voyager à Paris, Londres et Rome, « au gré de la Nouvelle Vague et de la Swinging London ».
Ce parcours scolaire et culturel l’élève socialement, lui permettant de « saute(r) de classe » par la force de l’esprit. Pour Julia, cette partie du roman est l’occasion de plonger dans des archives, de lire les journaux de l’époque et d’analyser les photographies jaunies du grenier familial.
Du document à la fiction : creuser les archives et le silence
Pour nourrir son récit, Julia Deck a fouillé les registres scolaires, les annuaires professionnels et même quelques journaux locaux anglais. Mais le véritable trésor est le seul carnet de bord de sa mère, dont deux étaient déjà détruits. Grâce à ce précieux document, elle reconstitue :
- Les adresses successives à Manchester, Liverpool et Londres.
- Les prénoms et visages de camarades de promotion devenus figures de la contre-culture.
- Les rendez-vous manqués, les refus de bourses, les petits mensonges qui forgent un parcours.
Julia souligne l’importance de ces silences non partagés, qui ont créé entre elle et sa mère « une porte fermée ». En transformant ces éléments en roman, elle rend visibles les zones d’ombre familiales.
La quête de vérité : un regard changeant
Le roman tord le cou à l’idée d’une vérité unique. Julia apprend que :
- La « vérité » est moins une donnée factuelle qu’un récit choisi, qui aide à vivre avec les autres.
- Les souvenirs se recomposent, se fragilisent ou se modifient selon l’affect et le temps qui passe.
- L’écriture devient un outil pour négocier la complexité des liens mère-fille.
En refusant de livrer une révélation brutale, elle laisse au lecteur l’espace pour interroger la notion même d’objectivité.
Ironie et sensibilité : le ton de l’auteur
Dans les moments les plus lourds, Julia Deck injecte un humour fin, « hérité du côté britannique » de sa famille. Cette distance ironique joue un rôle vital :
- Elle permet de rendre plus supportable le drame médical et bureaucratique.
- Elle souligne l’absurdité de certaines situations, comme les formulaires interminables ou les barrières linguistiques.
- Elle invite à sourire face aux rigidités sociales et institutionnelles.
D’un passé recomposé à une identité plurielle
À la fin du roman, l’autrice pose une question essentielle : quelle est la langue maternelle de celle qui navigue entre deux pays ? Elle constate :
- Son ancrage en France, malgré une affection intacte pour l’Angleterre de son enfance.
- La sensation d’être « étrangère » malgré un sentiment d’accueil constant.
- La richesse d’une identité binationale, qui façonne sa vision du monde.
Par le cheminement de Julia Deck, le lecteur découvre qu’un nom, Ann, peut devenir le prisme d’une histoire familiale, sociale et culturelle complexe, révélant combien la relation à la mère est un territoire à la fois intime et universel.